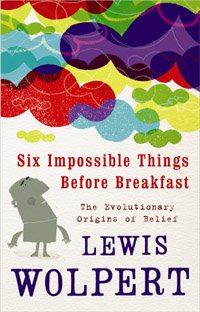Mère patrie
Demain je rentre pour quelques jours en France. Je ne bloguerai donc probablement pas la semaine prochaine ! Mais ma conscience politique va sûrement se trouver régénérée par un séjour dans notre patrie en pleine fronde...
En attendant, je vous laisse méditer sur une question hautement politique qui me taraude depuis quelques mois déjà : cela fait plus d'un an que je lis des blogs, et j'ai de plus en plus l'impression que sur le plan politique, la blogosphère est majoritairement de droite, et ne s'assume en général pas, la stratégie optimale étant de substituer un raisonnement scientifique ou juridique -les avocats adorent bloguer- à une opinion bien affirmée. L'exemple du CPE récent en est une caricature. Même s'il ne s'agit pas d'un blog, souvenons-nous également de cet article mythique du Figaro, intitulé "Moi, lycéen, je suis pour le CPE", écrit par un papi de 80 ans... Récemment ont également fleuri quelques opinions assez tranchées sur notre système de recherche, opinions largement à côté de la plaque selon moi et étant typiquement le fruit de considérations/comparaisons pseudo-rigoureuses avec d'autres pays . Tout cela pour dire que le blog me paraît être bien souvent un moyen d'expression de personnes bien établies, avec des opinions assez arrêtées sur pas mal de problèmes, mais un peu déconnectées de certaines réalités du terrain -c'est mon sentiment pour la recherche en particulier, et cela ne m'inspire par corollaire rien de bon sur les blogueurs parlant de société ou d'économie- d'où une "droitisation" du discours, étant donné que les solutions dites "réalistes" sont plutôt d'inspiration libérales socialement et économiquement. Alors, votre opinion ?
En attendant, je vous laisse méditer sur une question hautement politique qui me taraude depuis quelques mois déjà : cela fait plus d'un an que je lis des blogs, et j'ai de plus en plus l'impression que sur le plan politique, la blogosphère est majoritairement de droite, et ne s'assume en général pas, la stratégie optimale étant de substituer un raisonnement scientifique ou juridique -les avocats adorent bloguer- à une opinion bien affirmée. L'exemple du CPE récent en est une caricature. Même s'il ne s'agit pas d'un blog, souvenons-nous également de cet article mythique du Figaro, intitulé "Moi, lycéen, je suis pour le CPE", écrit par un papi de 80 ans... Récemment ont également fleuri quelques opinions assez tranchées sur notre système de recherche, opinions largement à côté de la plaque selon moi et étant typiquement le fruit de considérations/comparaisons pseudo-rigoureuses avec d'autres pays . Tout cela pour dire que le blog me paraît être bien souvent un moyen d'expression de personnes bien établies, avec des opinions assez arrêtées sur pas mal de problèmes, mais un peu déconnectées de certaines réalités du terrain -c'est mon sentiment pour la recherche en particulier, et cela ne m'inspire par corollaire rien de bon sur les blogueurs parlant de société ou d'économie- d'où une "droitisation" du discours, étant donné que les solutions dites "réalistes" sont plutôt d'inspiration libérales socialement et économiquement. Alors, votre opinion ?